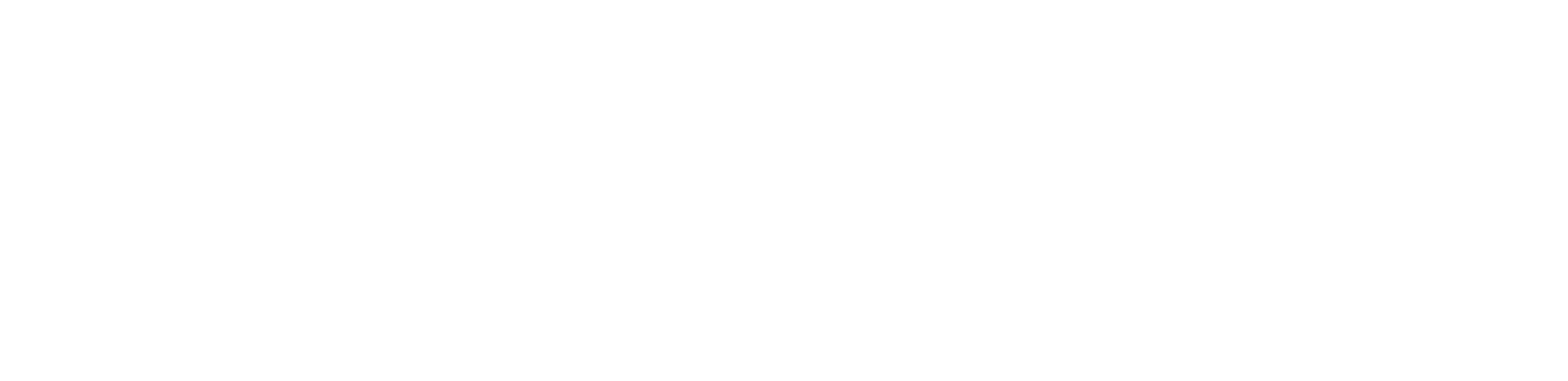Le baryton allemand a comblé le vide laissé par la disparition de Dietrich Fischer-Dieskau, qui avait régné presque sans partage sur le Lied durant toute la seconde moitié du XXᵉ siècle. Évidemment, la voix, plus sombre et plus dense que celle de son prédécesseur, n’est pas la même, mais Matthias Goerne s’est imposé depuis longtemps comme un récitaliste hors pair, grâce à une diction constamment au service du texte et une expression tournée vers l’intérieur. Peu attiré par l’opéra qu’il aborde avec parcimonie, il demeure avant tout un interprète de Lied et d’oratorio.
Né en 1967 dans une famille d’artistes en République démocratique allemande, il a grandi dans un pays où le chant imprégnait la culture quotidienne. De ces années, il a conservé de vives émotions, comme le choc d’avoir entendu Peter Schreier, accompagné par Sviatoslav Richter, dans une Winterreise de Schubert qu’il reprendra si souvent lui-même. Ce mélange de sensualité et de rigueur textuelle l’a marqué à jamais. Après des études à la Musikhochschule de Leipzig, il se perfectionne auprès de Dietrich Fischer-Dieskau et d’Elisabeth Schwarzkopf. Du premier, il reçoit l’encouragement à trouver sa propre voie, sans imitation servile ; de la seconde, une discipline sévère mais qui l’obligera à se révéler à lui-même.
À l’opéra, il a choisi ses rôles avec une rare exigence. On l’a vu dans un Wozzeck bouleversant à Zurich, à Covent Garden et au Met, dans Wolfram de Tannhäuser, Lear d’Aribert Reimann ou encore Mathis Grünewald dans Mathis der Maler de Hindemith. Papageno dans sa jeunesse, il a gagné avec les années la gravité de Sarastro. Mais c’est surtout dans le Lied qu’il a écrit l’histoire : son Winterreise, toujours différent, toujours plus habité, se déploie avec une intensité intérieure qui frôle parfois l’hallucination. Avec ses pianistes – Bar-Shai, Eschenbach, Brendel, Leonskaya, Andsnes, Trifonov, Wang – il établit un dialogue égal, laissant s’épanouir une vision sans cesse renouvelée.
Son chant, suspendu sur le souffle, dans une économie de moyens bouleversante, se retrouve dans Schumann (Liederkreis, op. 39), dans ses Schubert d’une tendresse infinie, mais aussi dans ses incursions plus inattendues : Hanns Eisler, dont il a révélé la puissance politique et poétique, ou encore des cycles rares de Pfitzner, Chostakovitch et Brahms. Ces dernières années, il a multiplié les collaborations avec orchestre : Des Knaben Wunderhorn de Mahler, les cycles orchestrés de Schubert, mais aussi des incursions vers Wagner. Son Wotan, enregistré à Hong Kong avec Jaap van Zweden, témoignait déjà d’une évolution vocale vers un registre plus ample et dramatique.
À près de soixante ans, Matthias Goerne poursuit une carrière qui allie exigence et liberté. Ses enregistrements récents chez Harmonia Mundi et Deutsche Grammophon – notamment un vaste cycle Schubert, puis des albums consacrés à Brahms, Mahler et Strauss – montrent un artiste toujours en quête d’approfondissement. Il se produit aujourd’hui avec les plus grands chefs (Thielemann, Nelsons, Nézet-Séguin) et de jeunes pianistes avec lesquels il aime ouvrir de nouveaux dialogues. Sa voix, gagnant en obscurité et en densité, conserve un pouvoir d’envoûtement intact, et son art du phrasé, capable d’étirer la ligne avec un legato hypnotique, demeure incomparable.
La magie de Matthias Goerne ne tient pas seulement à la couleur unique de son timbre, mais à cette subjectivité radicale qui transforme chaque Lied en paysage intérieur. Il a le don de suspendre le temps en quelques mesures, d’ouvrir pour l’auditeur un espace où le silence lui-même semble chanter.